 Après le revenu de base et l’entreprise sans hiérarchie, Reporterre poursuit sa série d’enquêtes sur les alternatives qui peuvent changer la société, Du local au global. En se demandant ce qui se passerait si les solutions n’étaient pas alternatives, mais appliquées à grande échelle. Troisième volet : les monnaies locales complémentaires.
Après le revenu de base et l’entreprise sans hiérarchie, Reporterre poursuit sa série d’enquêtes sur les alternatives qui peuvent changer la société, Du local au global. En se demandant ce qui se passerait si les solutions n’étaient pas alternatives, mais appliquées à grande échelle. Troisième volet : les monnaies locales complémentaires.
Samedi matin au marché de Trentemoult, petit village de l’agglomération nantaise. Une quinzaine de commerçants ont déballé leur stand au bord de la Loire. Parmi eux, trois se distinguent. Fromages, confitures, fruits et légumes : chez eux, tout peut s’acheter aussi bien en euros qu’en retz’L, la monnaie locale du pays de Retz (prononcer « ré »). Outre les cabanes de pêcheurs qui ont remplacé les ponts européens sur les billets, on remarque peu de différence dans le geste banal de paiement. Pourtant, ce sont deux visions de l’économie qui se côtoient ici.
Derrière son étalage de confitures, Anne Kermagoret accepte les retz’L depuis peu de temps : « J’ai été intéressée par le côté militant avant tout, contre la spéculation. Et puis, cela amène davantage à parler avec les gens. » En face, Anne Blomqvist vend des fruits et légumes bio en retz’L depuis deux ans. Elle a constaté une augmentation de la circulation de la monnaie locale depuis la diffusion du documentaire Demain : « Cela remotive, car on retrouve le sens de la démarche globale », explique-t-elle. Le sens d’une monnaie locale ? C’est d’abord de relocaliser la production et la consommation dans un cercle proche, de développer une forme de « résilience », mais aussi de « renforcer le lien social à travers nos échanges », favoriser le développement d’activités, et « refuser la spéculation » (voir le Manifeste pour les monnaies locales complémentaires).
« Une mobilisation citoyenne tout à fait impressionnante »
Un peu plus loin, dans le bourg limitrophe de Bouguenais, d’où est parti le Retz’L en 2012, la boulangère se montre un peu moins enthousiaste : « Je l’utilise car des clients me l’ont demandé, et pour le fun. Mais je ne suis pas convaincue... » Même distance chez sa voisine, épicière : « L’objectif est que tout le monde s’en serve, mais pour l’instant ce n’est que certaines personnes, des militants. Alors je ne reçois pas beaucoup de retz’L et je les reconvertis toujours en euros. » Et pour cause : seuls 300 utilisateurs et 150 professionnels utilisent les environ 20.000 retz’L en circulation. « L’adhésion à ces monnaies reste faible car les gens ne sont pas informés de toutes les dimensions que cela comporte, reconnaît Philippe Derudder, qui promeut la création de monnaies locales complémentaires (MLC) depuis une dizaine d’années en France. Or, il faudrait davantage d’utilisateurs pour que les MLC aient une réelle pertinence ».
C’est en effet le paradoxe actuel des MLC. De plus en plus d’associations se créent pour lancer des monnaies locales. Depuis la première en France, l’Abeille de Villeneuve-sur-Lot en 2010, plus d’une trentaine sont entrées aujourd’hui en circulation (carte). Et encore une trentaine en préparation, dont une à Paris, en collaboration avec la mairie. Sans compter leurs cousines, autres monnaies sociales et systèmes d’échanges locaux (SEL) aux fonctionnements différents [1]. « En très peu de temps, les MLC ont pris finalement pas mal d’ampleur dans notre pays. Cela veut dire qu’il y a une mobilisation citoyenne tout à fait impressionnante », analyse Christophe Fourel, coauteur du rapport D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité et chef de la mission Analyse et stratégie au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Parmi les succès notables, la monnaie du Pays basque, qui compte 3.000 adhérents, 600 entreprises et 460.000 euskos en circulation. Mais dans un grand nombre de cas, les groupes locaux peinent à atteindre un nombre suffisant de participants pour lancer une vraie dynamique économique.
« Pour qu’une MLC fonctionne vraiment bien, il faut trois acteurs : des citoyens utilisateurs, des prestataires et commerçants, et des collectivités locales », selon Jean-François Ponsot, maître de conférence en sciences économiques à l’université Grenoble Alpes. Or, aujourd’hui, le 3e ne joue pas le rôle moteur qu’il aurait si les salaires versés par les collectivités locales, leurs achats, et les impôts prélevés, étaient en monnaie locale.
Un côté éducation populaire ou atelier constituant
En Allemagne, des MLC ont existé dès le début des années 2000, mais sans aucune reconnaissance de l’État. « Une commune a essayé d’accepter les impôts en monnaie locale, mais elle s’est fait contrôler par l’administration, qui n’en voulait pas », nous raconte Christophe Levannier, du chiemgauer, la monnaie locale de Bavière. Résultat, l’essor attendu des MLC a tourné court, et seul le chiemgauer s’est développé. En France, la loi sur l’économie sociale et solidaire de 2014 a permis la reconnaissance des MLC. Mais sans régler la question de leur utilisation par le secteur public, qui devrait être étudié à l’Assemblée nationale en septembre prochain. Techniquement, rien ne s’y oppose, et certaines mairies ont déjà commencé à accepter des monnaies locales dans des maisons de quartier, centres de loisirs, cantines scolaires ou crèches.

Si l’effet des monnaies locales sur l’économie réelle reste pour l’heure très limité et difficilement quantifiable, il se pourrait que leur intérêt principal réside dans le décodage et l’appropriation de la monnaie par les citoyens. « La plupart des gens ne savent pas comment fonctionne la monnaie, comment elle est créée, et en même temps ils entretiennent une relation très passionnelle avec elle », selon Christophe Levannier. Faire partie d’une MLC, c’est participer à la création ou à la gestion d’une monnaie, et cela implique de comprendre la mécanique interne. Comment est créée la monnaie ? À quoi correspondent les taux d’intérêt ? Une monnaie peut-elle être fondante (avoir un taux d’intérêt négatif) ? Ces questions incontournables donnent aux MLC un côté éducation populaire, ou atelier constituant.
« La monnaie, c’est du lien social, cela incarne des valeurs, des pratiques, des projets, rappelle Jean-François Ponsot. Or aujourd’hui, l’essentiel des crédits bancaires alimente la spéculation, c’est un détournement. Donc ce n’est pas étonnant que certains cherchent à se réapproprier la monnaie. C’est un phénomène sain », poursuit-il. À l’opposé d’une institution monétaire européenne (la Banque centrale) qui parait très éloignée et technocratique, l’échelon local permet aux citoyens ainsi réunis de décider du fonctionnement de leur monnaie de manière démocratique, en assemblée générale.
Une monnaie complémentaire nationale, le Coopek
Et cela en partant des défauts de l’actuelle : « L’euro est très efficace pour les échanges internationaux, mais présente un inconvénient : elle détruit les structures locales », soutient Christophe Levannier. D’où la nécessité de monnaies locales véritablement « complémentaires », opérant chacune à une échelle différente. « La production de vêtements par exemple, sera plutôt nationale ou européenne. Même chose pour les smartphones et autres produits manufacturés. Donc il serait intéressant que les monnaies locales travaillent en réseau : j’ai un compte en euskos, mais je peux faire une conversion vers une autre monnaie locale », explique Dante Edme-Sanjurjo, coprésident de la monnaie basque..
Et cela ne serait d’ailleurs pas nouveau. Jusqu’au début du XXe siècle, plusieurs types de monnaies circulaient en même temps, « monnaies de cuivre ou de billon pour les échanges de base des communautés villageoises, d’argent pour les échanges nationaux et la fiscalité d’or pour les échanges internationaux et la diplomatie », rappellent Bruno Théret et Wojtek Kalinovski dans Les Dossiers d’Alternatives économiques consacrés à la monnaie. Les MLC prônent donc la diversité monétaire, renforçant la résilience des économies, contre la « monoculture monétaire », plus sensible aux crises.

- Le siège de la Banque centrale européenne, à Francfort (Allemagne).
Justement, après les monnaies locales, une monnaie complémentaire nationale, entièrement numérique, devrait voir le jour en octobre prochain : le Coopek. Imaginée par les dirigeants de Biocoop, cette monnaie sera gérée par une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), et utilisable par tout le monde à condition d’adhérer à la SCIC. « La spéculation est le cancer du système monétaire européen : l’argent ne circule pas et se multiplie sur lui-même. Le Coopek, lui, servira le développement de l’économie réelle », insiste Claude Gruffat, président de Biocoop.
Mais n’y a-t-il pas un risque que monnaies locales et monnaie nationale entrent en concurrence ? « La cohérence d’une monnaie locale, c’est de se connaître, partager quelque chose, avoir une chance de se rencontrer physiquement. Si l’on est au niveau du pays entier, ça n’a pas le même sens. Il faudra faire attention que cette monnaie-là ne vienne pas capter l’attention au détriment des monnaies plus intéressantes qui sont locales », prévient Dante Edme-Sanjurjo, qui n’est pas le seul à s’inquiéter. Claude Gruffat assure que tout sera fait pour que la cohabitation se passe bien, et défend l’intérêt de l’échelle nationale : « Aujourd’hui, dans huit entreprises sur dix, l’argent vient d’ailleurs que du local, donc il faut tenir compte de ces périmètres. La monnaie nationale permettra une meilleure circulation d’argent, et renforcera l’économie locale. » Il donne l’exemple des magasins Biocoop, qui appartiennent à un réseau national, mais proposent également des produits locaux.
Critiquer et repenser le système économique dominant
Pour relocaliser l’économie, il existe un autre outil : la mise en place de droits de douane selon la provenance des produits qui passent la frontière, également appelé protectionnisme. « Les MLC correspondent à ce qu’on peut faire au niveau citoyen, mais dans une approche plus politique, il serait tout à fait intelligent de revenir à du protectionnisme pour équilibrer les échanges », selon Philippe Derudder. La solution ne séduit pas les décroissants, qui y voient une « réaction palliative de protection réflexe ».
Reste que le chemin de monnaies locales conduit à critiquer et repenser le système économique dominant. « L’idée d’avoir une monnaie qui soit vraiment au service de l’économie réelle, au-delà des MLC, passe par la réforme du système de financement de l’économie : contrôler le crédit en nationalisant des banques ou en mettant en place une gouvernance coopérative, se débarrasser des banques d’affaires, faire une réforme bancaire en profondeur, etc. » lance Jean-François Ponsot.
Parmi ces idées, celle de permettre l’émission d’une monnaie publique à l’échelle locale ou nationale semble faire son chemin. Philippe Derudder travaille sur une « monnaie nationale complémentaire pour financer le bien commun ». Il s’agirait de financer par la création d’une monnaie alternative (non compensée par des euros, comme c’est le cas pour les MLC actuelles) l’économie de biens communs (la santé, l’éducation, la justice, etc.) et donc de la rendre indépendante du secteur marchand. Ce système pourrait également être mis en place à l’échelon local, en permettant aux monnaies locales de croître sans qu’il soit nécessaire de déposer des euros, afin de financer certains projets [2].
« Aujourd’hui les MLC sont des espaces de débat et de réflexion qui posent les questions de fond. Mais on ne sait pas s’il y aura des MLC dans le monde de demain », avoue Philippe Derudder. « L’outil MLC en lui-même n’a rien d’extraordinaire, il fonctionne quand les gens s’en emparent, ce n’est pas lui qui va révolutionner les choses », abonde Jean-Claude Chauvigné, du retz’L. L’essentiel serait plutôt dans notre imaginaire, notre conception des échanges en société. « La monnaie locale est un outil, ce qui est loin d’être suffisant pour faire société. Mais elle peut être assez pertinente pour accompagner une transformation sociale et culturelle : remettre le marché et l’économie à leur place, en dessous des valeurs conviviales et humaines », conclut le décroissant Vincent Liegey.
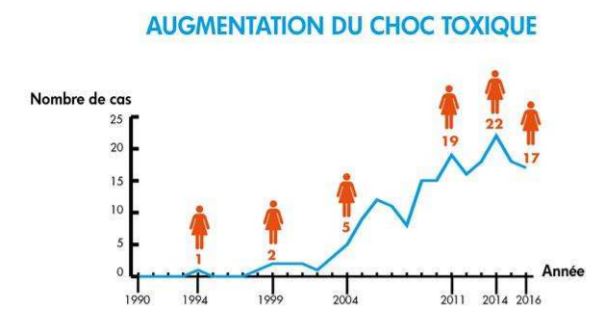



 Les tampons peuvent être responsables de choc toxiques. (Brad Cerenzia / FLICKR CC)
Les tampons peuvent être responsables de choc toxiques. (Brad Cerenzia / FLICKR CC)








